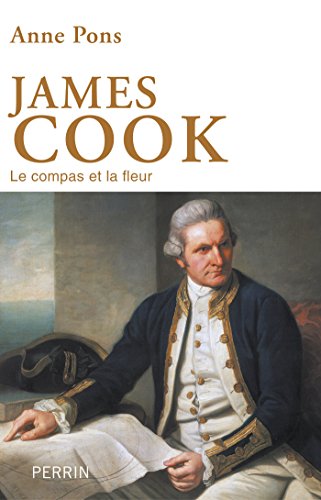MICHAEL COOK
C’est l’histoire de deux hommes qui s’appellent Cook. Le premier, James, est un navigateur et explorateur britannique qui en 1770 prend possession des deux tiers de l’Australie pour le compte de la couronne de Grande-Bretagne, ouvrant la voie à une future colonisation qui va se révélée dévastatrice pour la population indigène.
Le second, Michael, de père aborigène, a été adopté par une famille blanche qui a eu l’intelligence de ne pas lui cacher ses origines.
Devenu photographe, il interroge depuis une dizaine d’année l’histoire de son peuple et sa propre identité dans une œuvre mettant l’esthétique au service de son propos.
Et si les Européens n’étaient jamais venus? Se référant à l’histoire de son pays et en renversant complètement les perspectives, il invite le spectateur à considérer la sous-représentation aborigène dans la vie australienne en créant des scènes où ceux-ci sont majoritaires ou devenus les découvreurs et civilisateurs de leur propre pays.
C’est une salutaire remise en question des préjugés colonialistes indifférents à la culture et à l’histoire d’un peuple qui vivait en harmonie avec la nature, connaissance qui prend un singulier relief à un moment où incendies et inondations dévastent le pays.
Qu’est-ce qui vous a conduit à la photographie et quel est votre parcours professionnel?
J’ai commencé à créer des images artistiques en 2009, après quelques décennies de travail comme photographe commercial.
Cette expérience m’a donné une solide compétence technique que j’ai utilisée pour produire des images visuellement séduisantes qui illustrent les bouleversements que connaissent les peuples indigènes d’Australie depuis 1770, et qui se poursuivent encore aujourd’hui.
Mon travail porte sur mon identité et j’essaie de m’y référer autant que possible. Ma famille non-autochtone m’a élevé dans la fierté de mon héritage aborigène dans les années 1970, alors que le reste de la société ne le faisait pas.
Comme j’étais un enfant adopté, j’étais curieux de savoir d’où je venais et ma famille s’est toujours assurée que je comprenais la partie aborigène de mon identité.
Ma pratique photographique est particulière car je construis des images comme une peinture. L’image commence par une idée, puis j’utilise des couches photographiques pour construire et créer une profondeur esthétique. Je travaille également par séries d’images qui se déploient pour former un récit.
Dans ces séries, le sens n’est pas imposé mais laissé à l’interprétation du spectateur.
Vous avez commencé comme photographe commercial. Pourquoi avez-vous changé d’orientation?
J’ai toujours repoussé les limites pour atteindre un niveau qui, pour moi, me semblait être une réussite. On me proposait des mariages avec des célébrités internationales, mais j’ai découvert que travailler dans ce genre signifiait perdre le contrôle de la qualité.
J’ai donc laissé tomber. Mon associé m’avait vu travailler sur une série de sujets qui me trottaient dans la tête quand j’étais enfant. J’ai donc commencé à rassembler ces éléments et j’ai frappé aux portes des galeries.
Andrew Baker, marchand d’art à Brisbane, m’a accepté et, en une semaine, a vendu un jeu complet de ma première série «Through My Eyes» à la National Gallery of Australia.
Cette année-là, j’ai également réalisé «Undiscovered» et «Broken Dreams» et le musée a également acheté.
D’où vient votre inspiration et quel est le lien avec votre histoire personnelle?
J’ai été adopté et élevé par une famille blanche qui m’a permis de bien comprendre mon ascendance autochtone. Lorsque je produis mes images, je ressens un lien fort avec mes ancêtres. Cela m’aide à comprendre l’histoire australienne et en particulier la mienne.
Quel est le propos de la série «Through my eyes» et de «Majority Rule?
J’avais réfléchi au concept de «Through my eyes» depuis bien longtemps avant de commencer à la réaliser. Il s’agit d’une série de portraits, avec des visages d’Aborigènes superposés sur ceux de vingt-sept anciens premiers ministres australiens.
Ainsi, ces visages de personnalités politiques bien connues, comme Paul Keating et John Howard, me paraissent étrangement familiers mais aussi inconnus.
Je voulais mettre les spectateurs au défi de repenser l’histoire australienne de manière à ce que son histoire indigène en fasse partie intégrante.
Mon travail consiste à poser des questions et «Majority Rule» porte sur une hypothèse. J’ai imaginé que les autochtones seraient majoritaires.
Actuellement, les indigènes d’Australie sont une minorité, seulement trois à quatre pour cent de la population. Ces images inversent la tendance, avec des visages aborigènes envahissant les scènes urbaines.
La majorité impose toujours la règle, pas la minorité.
Il en résulte un racisme. Cette série reconnaît donc la nature discriminatoire de la société.
Ainsi, par exemple dans cette photo où un même homme autochtone apparaît encore et encore dans des attitudes multiples, debout, toujours figé, dans un espace de transport public généralement caractérisé par la précipitation des gens et les courants d’air qui souffle à travers ces espaces souterrains à l’arrivée et au départ des trains.
Les individus sont figés dans leur cocon serré de béton et de carrelage. Le conformisme des vêtements, des comportements et des normes sociales, est un autre thème de cette série.
Et celui de «Civilised»?
La série se réfère aux quatre pays européens qui sont venus en Australie avant et au début de la colonisation: les Pays-Bas, l’Espagne, l’Angleterre et la France.
Je pose ici la question suivante: «Qu’est-ce qui fait qu’une personne est civilisée?»
Je m’interroge sur une évolution historique potentiellement différente si les Européens avaient compris et apprécié le niveau d’équilibre et d’harmonie environnementale atteint par les peuples autochtones, l’une des cultures les plus anciennes et les plus stables au monde.
Après un été d’horreur en Australie, marqué par des feux de brousse et maintenant des inondations, l’approche du peuple indigène de ce continent et sa capacité à gérer l’environnement avec une telle sensibilité avant la colonisation est de plus en plus manifeste.
«Invasion» évoque la colonisation de l’Australie par les Européens mais se déroule à Londres et dans le style d’un film de série B des années 60? Pourquoi avoir choisi ce genre de mise en scène?
J’ai pensé aux Aborigènes et à ce qu’ils ont enduré il y a 250 ans. Ils vivaient sur leurs terres depuis des milliers d’années. Puis, des bateaux sont arrivés.
C’était la première fois qu’ils voyaient des peaux blanches, des mousquets et la violence qui faisait mourir les gens à côté d’eux.
Les vêtements, la musique, tout ce qui est sorti de ces navires a dû être complètement stupéfiant.
Dans la société d’aujourd’hui, j’ai pensé que ce qui nous effraierait à un niveau similaire, pourrait être les OVNI et une attaque dans nos villes.
Je voulais créer de l’empathie autour de ce que les autochtones ont vécu.
Des créatures extraterrestres envahissent les paysages urbains emblématiques de Londres et les citadins blancs en deviennent les victimes.
Il s’agit d’une version satirique de l’histoire coloniale australienne, renversant le point de vue dominant.
Dans ma pratique, j’utilise la subversion visuelle associée avec l’esthétique pour produire un fort sous-entendu politique. «Invasion» est probablement ma série la plus satirique à ce jour.
J’ai développé un côté ironique et parodique pour exprimer le choc qui a secoué le continent australien lorsque des Européens sont apparus sur les côtes du pays.
Et dans cette série, je retourne la situation en introduisant des espèces animales locales, oiseaux sans plumes, vers de terre de très grande taille, lézards géants, opossums juchés sur des soucoupes volantes, femmes robots à laser et nuages de loriquets arc-en-ciel dans la ville de Londres, la « mère » patrie, pour y faire des ravages.
D’une manière générale, je crée des mini-récits qui parlent du passé, et j’utilise des références historiques pour démasquer et inverser les pratiques racistes imposées aux autochtones.
Le drame de cet événement imaginaire est renforcé par l’utilisation d’une esthétique vintage de film d’horreur de série B.
Quel est votre point de vue sur la situation actuelle des Aborigènes en Australie?
On ne m’a jamais enseigné l’histoire des Aborigènes à l’école, mais seulement celle de la colonisation européenne. Ce que j’y ai appris était similaire aux croyances des premiers colons avec des mots comme «indigènes» et «découverte de l’Australie».
Avec le recul, je me rends compte que c’était une mauvaise façon d’enseigner et qu’elle cachait la vérité sur le traitement des Aborigènes au cours des quatre cents dernières années.
Après l’arrivée des explorateurs, la population native a été décimée. Cela était dû en partie au fait que les habitants n’étaient pas immunisés contre les maladies introduites, mais il y a eu aussi des massacres et des expulsions forcées de personnes, une atteinte délibérée à leur culture et à leur mode de vie.
Aujourd’hui encore, nous sommes témoins des dégâts causés par l’arrivée des Européens. Les problèmes sociaux sont importants, l’espérance de vie des autochtones est en moyenne de 7,8 ans inférieure à celle des non-autochtones et le racisme continue d’avoir un impact à de nombreux niveaux.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment?
Je prépare, pour «Paris Photo New York», une nouvelle série intitulée «Mr & Mrs Jones» qui traite des aspirations, du consumérisme, du conformisme et des dommages que le matérialisme cause à la société.
Peut-être que chacun est aveugle à ce qu’il possède réellement. Si l’on fait comme les Jones, si l’on convoite ce que les autres possèdent, cela peut signifier que les gens passent à côté de ce qui est juste devant eux.
La communauté, l’amour de soi et des autres et le fait de donner en retour, ce qui est là pour tout le monde et à tout moment. Pourtant, nous semblons tous nous éloigner des relations humaines qui comblent le vide et des connections qui nous font nous sentir entiers.
Propos recueillis par Gilles Courtinat
James Cook Format Kindle
Réalisées entre 1768 et 1779, les trois circumnavigations du capitaine Cook, le plus illustre navigateur et cartographe qu'ait produit l'Angleterre, marquent le début des grandes explorations scientifiques du siècle des Lumières.
Déterminé à se rendre là où non seulement " aucun homme n'était encore allé mais aussi loin qu'il était possible d'aller ", accompagné de nombreux savants et artistes, il rapporta de ses voyages une masse d'informations sur les mœurs et les coutumes des populations indigènes les plus méconnues du globe, en particulier l'Océanie.
Il mit un point final au mythe de la
Terra australis et releva de nombreuses cartes des terres qu'il découvrit ou localisa, dont la Nouvelle-Zélande, la côte orientale de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, l'archipel des îles Tonga, les Nouvelles-Hébrides et les îles Sandwich.
Fidèle aux instructions du roi George III, l'homme que Louis XVI citera en exemple à Lapérouse avant son tour du monde tenta d'entretenir les meilleures relations avec les naturels jusqu'à ce que son épuisement et une santé vacillante aboutissent à sa mort violente sur une plage de Hawaï.
Membres qui aiment ce contenu
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 25 autres membres